Le stress, omniprésent dans notre vie.
Bon et mauvais stress
Le stress est une réaction physiologique naturelle qui permet à notre organisme de mobiliser nos ressources face aux changements.
C’est un mode de réaction que tout individu adopte pour faire face aux différentes situations de la vie quotidienne (mariage, naissance, travail, deuil…) L’ensemble de ces ces situations sont appelés des « stresseurs ».
Lorsque l’action est possible et que la réaction de l’individu est adaptée, on parle de bon stress. Ses causes sont perçues comme positives. Elles procurent énergie et motivation pour relever un défi, au cours d’un entretien d’embauche, ou d’une course pour un sportif par exemple. Ce bon stress permet de « se dépasser ».
À l’inverse, si l’action n’est pas possible et que la réaction de l’individu n’est plus adaptée, le stress devient une source d’épuisement. On parle alors de mauvais stress, source de « dérèglements » nombreux et variés.
Les trois phases du stress
Hans Selye, médecin autrichien endocrinologue, fut l’un des premiers chercheurs à s’intéresser au stress. Il a mis en évidence l’existence de trois phases distinctes.
Phase d’alarme
Intense et de courte durée, cette réaction est parfois précédée d’un état de choc. C’est la réaction de survie immédiate dans laquelle l’individu mobilise très rapidement des ressources.
Elle correspond à l’ensemble des réponses biologiques permettant à l’individu de résister dans le temps, c’est à dire de survivre. Certaines structures du cerveau (hypophyse et hypothalamus) vont fabriquer des hormones au cours de cette phase pour ressourcer le corps permettant une augmentation du taux de glycémie nécessaire à l’organisme, au cœur, au cerveau et aux muscles.
Phase de résistance
À force de sollicitations, les systèmes neuro-hormonaux se dérèglent. Le rétrocontrôle de la phase de résistance ne s’opère plus.
Phase d’épuisement
A long terme, les taux excessifs d’adrénaline et de cortisol entraîne des symptômes plus importants : troubles cardiaques, digestifs (colites, ulcères à l’estomac …), troubles de la mémoire, dépression, burn-out …
Exemples d’agents stresseurs
Les agents stresseurs impliquent des demandes d’adaptation, auxquelles l’individu répond avec plus ou moins de succès. L’émergence d’agents stresseurs peut avoir de multiples sources.
Au travail
- surcharge de travail
- manque de reconnaissance
- difficultés relationnelles avec l’employeur
- ambigüité des rôles
- perte d’emploi…
Dans la famille
- difficultés relationnelles avec les membres de la famille
- divorce
- décès d’un membre de la famille
- peur de l’avenir
- perte d’autonomie liée au vieillissement
- solitude…
Dans notre vie personnelle
- conflit de valeurs
- soucis dans la relation amoureuse ou d’amitié
- maladie…
Les effets du stress chronique sur le corps
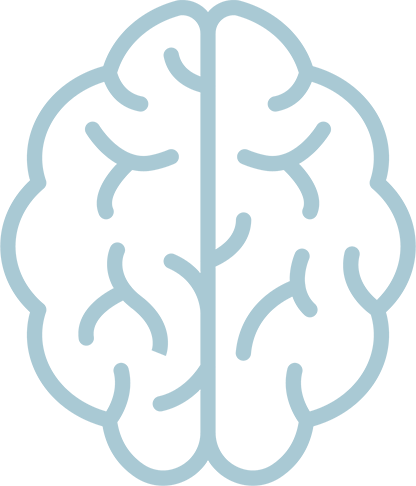
Le cerveau
Troubles neurologique et cognitifs
Maux de têtes récurrents, difficultés de concentration, troubles du sommeil… Un stress prolongé peut favoriser l’apparition de migraines et perturber le cycle veille-sommeil, allant jusqu’à l’insomnie chroniqueSanté mentale fragilisée
Sous pression constante, le risque d’épuisement professionnel (burn-out) augmente. L’irritabilité, l’anxiété ou la tristesse peuvent évoluer vers une dépression si le stress devient chronique.
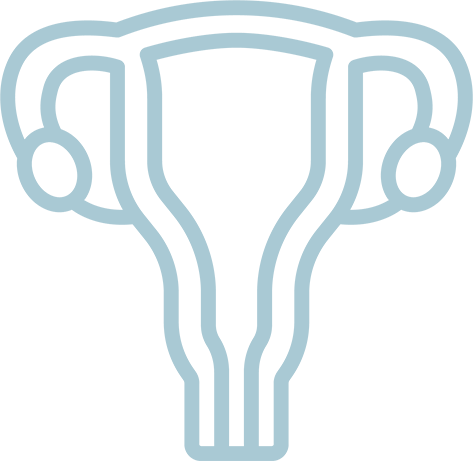
Système reproductif
Déséquilibres hormonaux
Chez les femmes, le stress peut perturber le cycle menstruel (règles irrégulières, absence de règles). Chez les hommes, il peut engendrer des troubles de l’érection. Dans les deux cas, la fertilité peut être affectée.
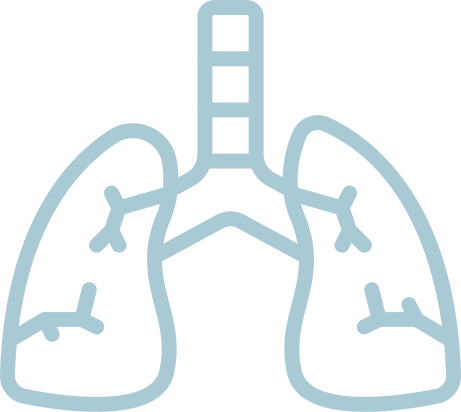
Les poumons
Respiration superficielle et accélérée en situation de stress aigu
Sensation d’essoufflement et d’oppression thoracique
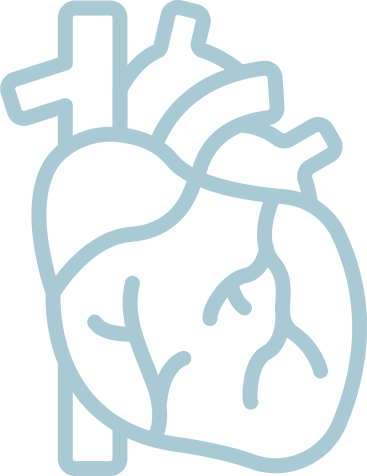
Le cœur
Sytème cardiovasculaire engagé
L’accélération du rythme cardiaque et l’augmentation de la tension artérielle, provoquée par la libération prolongée d’hormones du stress, peuvent favoriser l’hypertension, voire des troubles plus graves comme les infarctus.

Le foie
Perturbations métaboliques
Le foie, sous l’effet du stress, peut augmenter la production de glucose dans le sang, contribuant à un déséquilibre glycémique pouvant aller jusqu’au diabète de type 2.
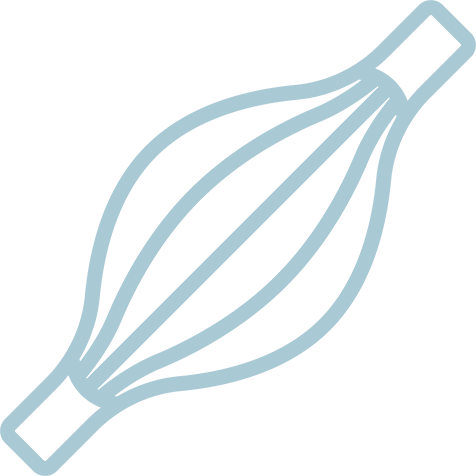
Les muscles
Tensions musculaires
Les muscles peuvent rester contractés de manière prolongée, provoquant douleurs et inconfort, notamment au niveau du dos, du cou, de la tête ou des épaules.
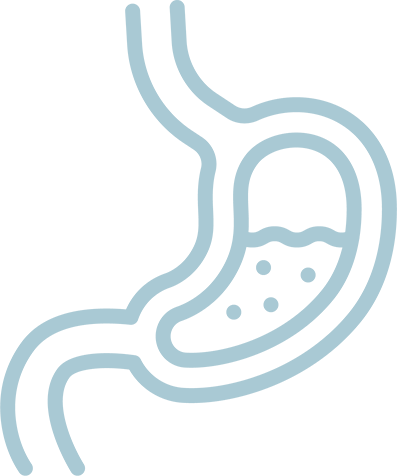
L’estomac
Appareil digestif perturbé
Le stress influe sur la sécrétion d’acide gastrique, provoquant brûlures d’estomac, nausées ou douleurs abdominales. Il peut également désorganiser le transit intestinal.
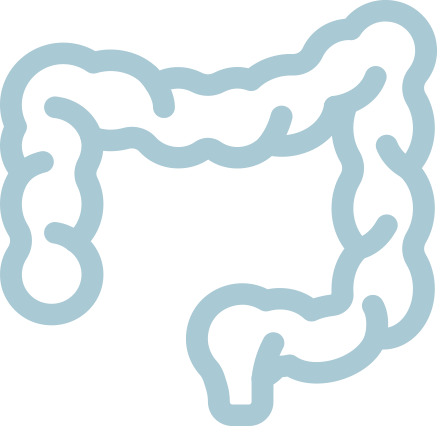
Les intestins
Altération du système immunitaire
Sous stress prolongé, les défenses immunitaires s’affaiblissent, rendant l’organisme plus vulnérable aux infections et ralentissant la récupération.
L’apport de la Réflexologie dans le traitement des Troubles fonctionnels liés au stress
Les troubles fonctionnels sont des désordres corporels réels, ressentis et souvent invalidants, mais sans cause médicale clairement identifiée. Ils sont liés à un déséquilibre du système nerveux autonome et à une surcharge de stress. Ce sont des signaux d’alerte du corps, qui expriment un mal-être ou une tension prolongée par des symptômes physiques, émotionnels ou comportementaux, avant qu’une pathologie ne s’installe.
La Réflexologie est recommandée pour traiter de nombreux Troubles fonctionnels liés au stress.
Troubles physiques
- fatigue inhabituelle
- troubles du sommeil
- troubles digestifs
- maux de tête
- problèmes cutanés
- problèmes respiratoires…
Troubles émotionnels ou physiologiques
- difficulté de concentration
- troubles de l’humeur, colère et irritabilité
- baisse de libido
- perte de l’estime de soi, repli sur soi
Troubles comportementaux
- troubles de l’appétit
- addictions
- absentéisme au travail

